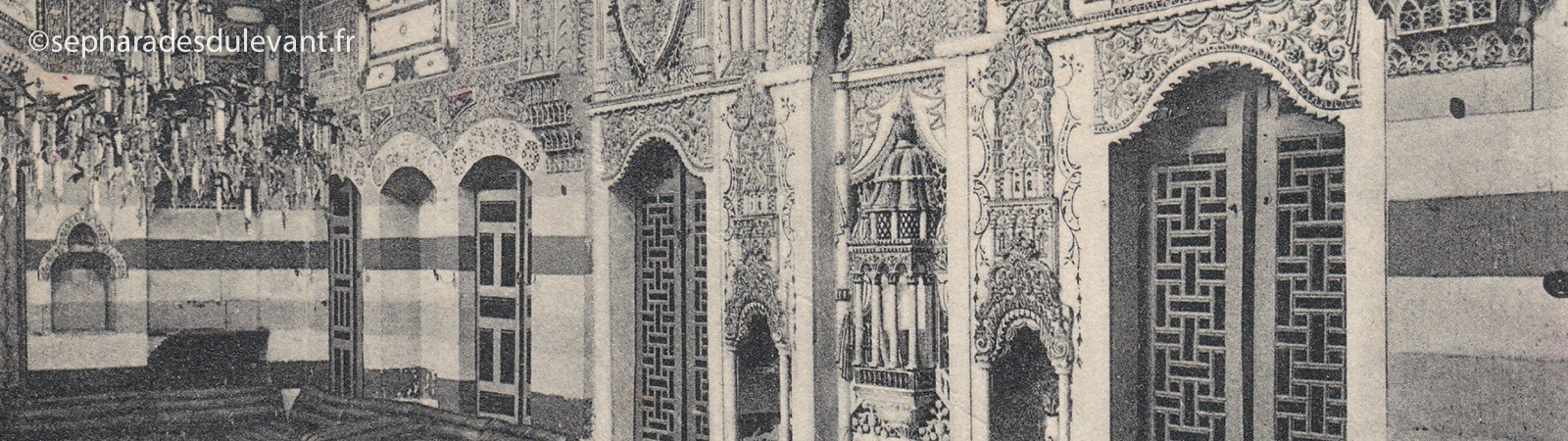Article publié le 18/03/2013 sur le site Les clefs du Moyen-Orient
Par Tatiana Pignon
Les dhimmî, non-musulmans « protégés » par l’État islamique, constituent dès les premiers temps de l’islam une catégorie sociale à part entière, dont le statut est ambigu. En effet, l’État musulman – umayyade comme abbasside – est un État théocratique, dans lequel seuls les musulmans disposent des droits civiques. Si le Coran prévoit explicitement un statut personnel spécifique destiné à « protéger » les « Gens du Livre », qui ne peuvent être convertis à l’islam par la force, ceux-ci demeurent tout de même « inférieurs » aux musulmans sur plusieurs plans : ils sont l’objet d’une discrimination, qui n’est à l’origine pas négative, mais qui comporte également des points soulignant leur infériorité. Cette institution originale, spécificité islamique, définit donc en premier lieu la condition – sociale et politique – des dhimmî dans l’Empire islamique ; mais ceux-ci, en conséquence, deviennent une part importante de la société islamique médiévale, et jouent notamment un rôle économique essentiel. Enfin, et malgré le bon fonctionnement général de cette institution, leur statut de non-musulmans en fait également, à plusieurs reprises, l’objet privilégié de persécutions ou de vexations qui peuvent prendre une ampleur remarquable ; sur ce point, l’impact des croisades et de l’arrivée des chrétiens d’Occident au Moyen-Orient, où ils s’établiront durant près de deux siècles, est d’une importance capitale.
L’institution de la dhimma
Le terme arabe de dhimma contient l’idée de « lien contractuel », « engagement », et plus précisément le type d’engagement qui lie un débiteur et son créancier. Il implique également les deux notions de protection et d’obligation. On trouve dans le Coran une occurrence de ce mot (IX, 8-10), qui est ensuite repris dans différents hadîth ; mais c’est traditionnellement au « pacte de ‘Umar », probablement daté de 717 [1], qu’on attribue la définition précise et l’institutionnalisation de la dhimma. Celle-ci s’inspire donc d’une obligation coranique, celle qui consiste à protéger les non-musulmans appartenant à des religions qui se réclament de la Bible, d’où leur nom de « Gens du Livre » (Ahl al-Kitâb) : il s’agit donc des chrétiens, des juifs, des sabéens et, parfois, des zoroastriens, qui possèdent également un livre saint – l’Avesta – constituant une révélation divine confiée à un prophète (Zoroastre) qui l’enseigna à ses disciples. Contrairement aux polythéistes, les Gens du Livre ne peuvent être forcés à se convertir à l’islam ; à l’inverse, le Coran stipule qu’il faut respecter leur foi et leur personne.
La dhimma est donc cette institution qui place les Gens du Livre sous la responsabilité de l’État islamique, qui doit garantir leur protection. Cette protection est soumise à plusieurs conditions, détaillées dans le pacte de ‘Umar, dont la première est de reconnaître la domination musulmane et de ne jamais la contester. Les dhimmî doivent également montrer du respect aux musulmans, ce qui passe par une pratique discrète de leur propre religion, par l’impossibilité de construire ou reconstruire des bâtiments religieux, par l’interdiction d’attaquer un musulman, d’acheter un de ses esclaves ou un de ses prisonniers et d’avoir des vues sur sa maison ou ses biens, par l’obligation de céder son siège à tout musulman qui voudrait s’asseoir, par celle d’héberger tout voyageur musulman qui le souhaiterait, et par l’interdiction formelle d’accueillir des « espions » ou de garder secrètes des informations concernant des actes qui pourraient nuire aux musulmans. Les dhimmî doivent également, là encore en signe de respect, se différencier des musulmans par leur tenue vestimentaire, et notamment porter une ceinture spéciale ; cette clause connaîtra au fil de l’histoire une codification de plus en plus précise, notamment à l’époque ottomane. Enfin, la protection accordée par l’État islamique aux non-musulmans est soumise à une dernière condition : les dhimmî doivent payer un impôt de capitation, la jizya, source de revenus importants pour l’État et origine à plusieurs reprises de mouvements de conversion motivés par le désir d’échapper à cet impôt, à tel point qu’au VIIe siècle, pendant une brève période, la conversion fut interdite en Irak par le gouverneur. À partir de 720, dans le but d’augmenter les recettes, le calife ‘Umar II établit un statut spécifique pour la terre : même convertis, même musulmans, les paysans possédant des terres autrefois non-musulmanes doivent désormais payer un impôt foncier, le kharâj.
Toutes ces obligations, si elles paraissent assez lourdes, sont conçues comme une contrepartie équitable à la protection qu’accorde l’État aux dhimmî : à l’époque des conquêtes, où il s’agit surtout pour les musulmans d’imposer leur domination sur un territoire toujours plus grand et non de convertir les peuples à l’islam, le paiement de l’impôt permet aux non-musulmans de conserver leurs terres et le droit de pratiquer leur religion. Lorsque la dhimma s’organise mieux, en conséquence d’un état de fait où tout ce qui relève du droit civil (mariages, funérailles, baptêmes, etc.) est géré au niveau communautaire, il est également établi que les différentes communautés de dhimmî conservent le droit d’appliquer leurs propres règles en matière sociale et même judiciaire, avec le maintien de juridictions spécifiques. Cette situation sera véritablement institutionnalisée sous l’Empire ottoman, qui instaurera le système des millet ou communautés confessionnelles.
Les dhimmî dans l’Empire islamique
Le statut juridique des dhimmî n’interdit a priori pas à ces derniers de pratiquer tel ou tel métier ; mais dans les faits, et dès le VIIe siècle – comme le montrent plusieurs hadîth du calife ‘Umar (634-644) – leur participation à l’administration publique, fiscale ou gouvernementale, est remise en cause. L’État islamique médiéval, umayyade comme abbasside, est en effet un État théocratique, où le lien politique est la conséquence directe de l’appartenance à une même communauté de croyants : pour certains, les non-musulmans n’auraient donc pas leur place dans les métiers du domaine public. Le calife ‘Umar II, au VIIIe siècle, est le premier à introduire d’importantes restrictions vis-à-vis des dhimmî, qu’il élimine de l’administration. Cette question reste toutefois controversée pendant plusieurs siècles, et sa réponse est bien souvent tributaire du contexte et du caractère du calife ou du sultan régnant : ainsi, le sultan Saladin, au XIIe siècle, n’hésite pas à employer des juifs et des chrétiens comme secrétaires ou comme médecins – on peut citer l’exemple célèbre du médecin juif Moïse Maïmonide. Hors du domaine de la cour califale ou sultanienne, une répartition de fait des métiers s’opère : les dhimmî ont en effet tendance à s’orienter vers les professions dévalorisées par l’islam, comme la boucherie ou la tannerie, mais aussi le commerce et la finance : ils s’approprient ainsi progressivement une part importante de l’économie de l’Empire, ce qui les amène à jouer un rôle social de plus en plus important, bien que très circonscrit. Au niveau des structures sociales elles-mêmes, les dhimmi s’organisent de manière communautaire : distingués des musulmans par leurs vêtements, écartés factuellement de certains métiers et milieux, ils pratiquent pour la plupart l’endogamie et vivent la quasi intégralité de leur vie sociale au sein de leur communauté d’origine. Les mariages mixtes existent au Moyen Âge, mais sont loin d’être la règle : ils posent de plus des problèmes importants sur le plan de la religion, mais aussi au niveau juridique, puisqu’il faut pour pouvoir se marier que l’un des deux époux sorte de sa communauté pour entrer dans une autre, en acceptant par là même le droit et les règles propres. Ce passage, nécessaire, d’une communauté à une autre est non seulement un acte douloureux au niveau individuel – puisqu’il s’agit bien de se séparer de sa famille et de son entourage, en plus du renoncement à sa foi ou à son mode de vie – mais aussi un risque important, l’intégration d’un nouveau membre dans une communauté étant souvent longue et difficile.
Entre coexistence et tensions
Le pacte de la dhimma institutionnalise donc juridiquement un état de coexistence pacifique entre musulmans et non-musulmans (à l’exception des païens, qui se font de plus en plus rares au sein de l’Empire islamique ; mais on a dit que le statut de dhimmî se trouve étendu au-delà des seuls Gens du Livre à proprement parler, puisque les zoroastriens y accèdent également). Si ce système fonctionne, dans l’ensemble, plutôt bien tout au long de l’existence de l’Empire de l’islam – il aura d’ailleurs une postérité importante, puisqu’il restera en vigueur dans l’Empire ottoman jusqu’à la chute de ce dernier en 1922 – les dhimmî demeurent des marginaux, et donc la cible privilégiée de persécutions en cas de difficultés contextuelles. À partir de l’échec arabe devant Constantinople en 717, les mesures discriminatoires sont renforcées ; au XIe siècle, le calife al-Hakîm (996-1021) va jusqu’à détruire le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Longtemps majoritaires, les dhimmî apparaissent en effet comme une force de contestation potentiellement très dangereuse, politiquement et économiquement : selon le principe du « bouc émissaire », ils sont donc les premiers à pâtir des crises économiques, politiques ou démographiques que connaît l’Empire islamique. La tendance s’inverse au IXe siècle, lorsque, sous l’effet des conversions notamment, les musulmans deviennent majoritaires au sein de leur État. Cette crainte renaît toutefois avec force dès lors que le contexte le permet : ainsi, la dynastie almoravide en Occident utilise la lutte contre les dhimmî – et notamment les Juifs de Grenade, lors des grandes persécutions de 1066 – comme moyen de légitimer un nouveau pouvoir qui se revendique de l’islam. L’impact des croisades, en Orient, est essentiel : de nombreux exemples montrent la méfiance des musulmans vis-à-vis des dhimmî chrétiens, suspectés de sympathie vis-à-vis des Croisés, et il y a des exemples d’exécutions préventives, comme à Antioche où les Arméniens étaient soupçonnés de collusion avec les assiégeants chrétiens. Associés à l’ennemi de par leur foi commune, malgré les grandes différences rituelles et même théologiques, les chrétiens d’Orient lui sont parfois même assimilés et traités comme tels ; ainsi, le cadi [2] d’Alep fait détruire toutes les églises de la ville en 1123, en représailles d’exactions commises par le comte de l’État latin d’Édesse dans la région. Enfin, plusieurs chefs musulmans choisissent de répondre à une situation de crise par un retour aux fondamentaux de l’islam à laquelle s’associe souvent une volonté d’épuration de la « terre de l’islam » (« dâr al-islâm »), qui s’oriente d’abord et surtout, pour des raisons évidentes, contre les dhimmî.
La situation des non-musulmans reconnus comme « Gens du Livre » est donc, dans l’Empire islamique médiévale, à la fois complexe et ambiguë : « protégés » par l’État musulman en vertu d’un pacte qui leur impose en retour l’obéissance à de nombreuses règles discriminatoires, les dhimmî sont en même temps, en raison de leur statut de minorité (même, paradoxalement, lorsqu’ils sont encore majoritaires au sein de l’Empire, aux VIIe-IXe siècles), les cibles d’attaques qui peuvent se traduire par l’exercice d’une grande violence. Avant tout tributaire du contexte, cette situation varie selon les lieux et les époques ; alors qu’ils sont, au moment des conquêtes, surtout perçus comme source de revenus pour un État islamique en construction, leur statut personnel et leur organisation générale devient de plus en plus problématique et controversée, au point qu’on pourrait presque parler d’une « question des dhimmî » au Moyen Âge. Il n’en reste pas moins que l’institution de la dhimma perdure, jusqu’à la chute de l’Empire ; elle sera reprise et réorganisée par l’Empire ottoman, du XVIe au XXe siècle.
Bibliographie
Milka Levy-Rubin, Non-Muslims in the early Islamic Empire : from surrender to coexistence, Cambridge University Press, 2011, 267 pages.
Bernard Lewis, Juifs en terre d’islam, Paris, Calmann-Lévy, 1986, 258 pages.
Bat Ye’ôr, Le dhimmi : profil de l’opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe, Paris, Éditions Anthropos, 1980, 335 pages.
Bat Ye’ôr, Les chrétientés d’Orient entre jihâd et dhimmitude : VIIe-XXe siècles, Paris, Éditions du Cerf, 1991, 529 pages.
[1] La plus ancienne version de ce texte qui nous soit parvenue date du XIIe siècle ; sa paternité est controversée, puisque certains veulent l’attribuer à ‘Umar ibn al-Khattâb (634-644) tandis que la plupart des historiens s’accordent aujourd’hui à dire qu’il s’agirait d’une compilation de textes élaborés progressivement, dont certains dateraient probablement du règne de ‘Umar II ibn ‘Abd al-Aziz (682-720).
[2] Juge musulman.