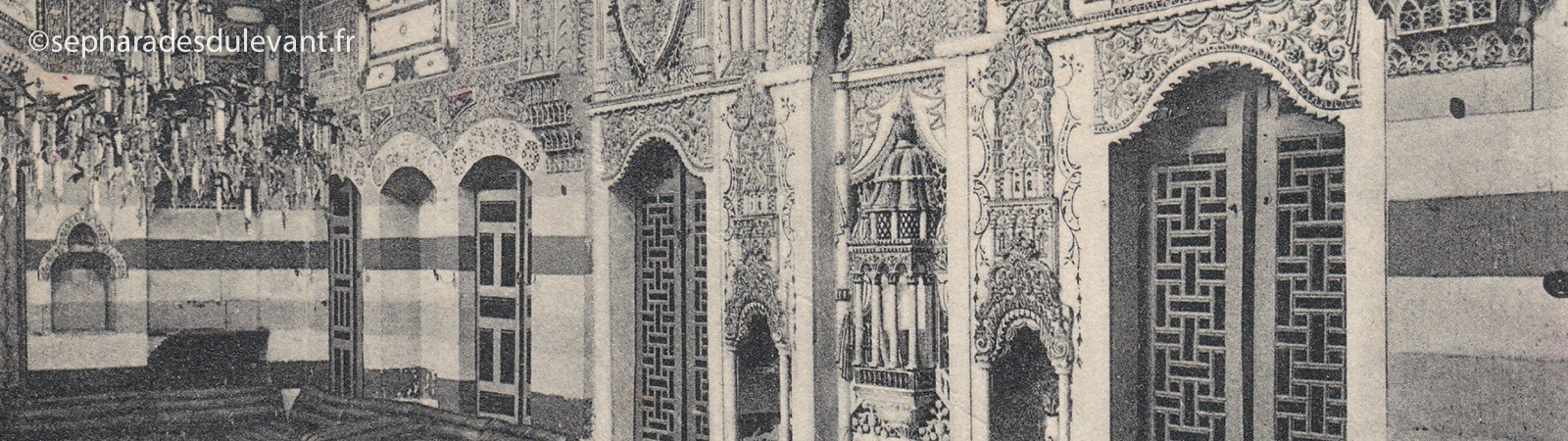Un témoignage qui a permis la reconnaissance comme Justes des Nations de Marie et Pierre Bellocq, instituteurs à Nay.
Mes parents décidèrent de quitter Paris vers la fin de l’année 1941 pour tenter de passer en zone libre car ils avaient peur des rafles. L’un de mes oncles, l’oncle Isaac Saul, avait été emmené au camp de Drancy (d’où il serait déporté vers Auschwitz). On avait peu de nouvelles des gens parqués et entassés à Drancy, mais chacun l’évoquait avec frayeur. Nous connaissions les conditions de voyage dans les trains à bestiaux vers des destinations inconnues. Qu’allions-nous devenir ? Dès 1940, mon père avait préparé dans notre appartement de la Cité Trévise une cache dans le canapé-lit du salon au cas où les Allemands ou, plus précisément la police française, viendraient le chercher ; à chaque fois que l’on frappait à la porte c’était la panique, mon père s’engouffrait dans le divan, puis ma mère allait ouvrir en tremblant. La sensation ou plutôt la réalité du danger était évidente pour nous, « être emprisonné parce que juif! » ne pouvait pas nous paraître admissible ou normal comme à bien d’autres qui l’admettaient avec indifférence. Il fallait fuir. Je venais d’avoir 7 ans. C’est ainsi que mes parents se dirigèrent naturellement vers les Basses Pyrénées et la région de Pau où déjà nombre de familles issues des communautés originaires de Turquie (Istanbul ou Izmir principalement) ou de Grèce (Salonique particulièrement) habitaient ou étaient déjà réfugiées. Les Pyrénées étaient le passage possible vers l’Espagne. En tant que Séfarades ils avaient l’avantage de parler couramment le djudezmo, leur langue maternelle, langue imagée issue de l’espagnol du XVe siècle.
Mon père quitta la capitale en vélo en compagnie de l’un de ses cousins, qui lui, volera un vélo pour pouvoir se sauver ! Jusqu’à son décès en 1995, ma mère évoquerait en rougissant, cette scène de vol avec des sentiments mêlés de honte et de fierté : « Tu te rends compte, me disait-elle, un vol de vélo était puni de mort à cette époque. » Ma mère, mon frère et moi partirons en voiture avec un ami de la famille qui nous déposera à Dax, poste frontière pour la zone libre, route vers l’Espagne. Je me souviens de ce voyage, comme si c’était hier. Depuis Paris, ma mère savait qu’il fallait se rendre dans l’un des cafés de la ville pour trouver un passeur. Je n’ai pas eu conscience, ni souvenir de la tractation, mais l’affaire fut rapidement conclue et rendez-vous pris pour le soir même. Le soir venu, nous nous retrouvâmes dans une ferme ; il y avait là autour de nous dix à quinze personnes, des hommes, des femmes ; mon frère et moi étions les deux seuls enfants. Dans cette grande pièce, tous étaient assez silencieux et inquiets, personne ne quittait son manteau. Assis autour de la grande table de ferme, on nous servit de la soupe. Il faisait déjà bien sombre. La nuit tombée, le passeur indiqua au groupe qu’il était temps d’y aller. Les gens étaient emmitouflés, la plupart avaient une petite valise, nous ne pouvions être chargés de bagages qui seraient acheminés autrement. L’homme portait un béret, nous le suivions à la queue leu leu sur un sentier ; la nuit était assez claire, nous traversions des champs, il ouvrait des barrières et les refermait derrière nous. Le ciel était clair, brusquement notre guide s’arrêta : « Vous voyez le chemin au bout du champ, ils passent par là pour faire leur ronde. » Il ne précisa pas si c’était les Allemands ou les gendarmes. Il se tut quelques instants. « C’est bon, on peut y aller. » Nous reprîmes notre route, ma mère marchait juste derrière lui, tenant par la main ses deux enfants. Tout à coup, il s’arrêta à nouveau : « Qu’est-ce que c’est que ce bruit? », dit-il en colère, en se retournant. C’était ma boite de pastilles Valda contenant mes économies, quelques pièces de monnaie qui tintaient dans la nuit. Ma mère toujours tremblante me prit la boite, le passeur la mit au fond de sa poche : « Je te la rendrai tout à l’heure après notre promenade », me dit-il en bougonnant. Nous continuâmes en silence et nous retrouvâmes sans encombres dans une autre ferme où avec mon frère nous dormirions jusqu’au petit matin. Les adultes devaient parcourir encore une dizaine de kilomètres avant d’être définitivement en zone libre. Avec Henri, qui avait cinq ans, nous passerions la ligne de démarcation dans la charrette d’un paysan tirée par un cheval, cachés au milieu d’énormes bidons de lait. Je revois encore cette petite route de campagne ; de loin j’apercevais une petite guérite sur le bord du chemin et la barrière déjà levée. Le fermier ne ralentit pas son allure, il fit juste un signe au gendarme qui ne bougea pas. Nous étions passés et retrouverions notre mère un peu plus tard.
Nous nous rendîmes à Pau, puis gagnâmes le village de Nay situé à une quinzaine de kilomètres plus au sud, nous y résiderons jusqu’en juin 1944. Mon père nous rejoignit quelques jours plus tard et nous vécûmes dans ce village en compagnie de plusieurs familles originaires d’Izmir, d’Aïdin et d’Istambul, les Algazi, les Lévy, Maurice et Albert. Maurice Lévy, se fera appeler Maurice Denailles après la guerre, en souvenir de son séjour à Nay. Mes parents avaient loué un petit appartement au-dessus de la boulangerie du village. Le Service de la main d’œuvre étrangère obligeait tous les réfugiés étrangers juifs à travailler dans la région, c’était l’occasion d’un contrôle permanent. Pour chaque déplacement hors de la commune de résidence un congé était établi par la gendarmerie. Mon père avait trouvé un travail chez un paysan (monsieur Matocq Grabot Jean). Pour lui qui avait toute sa vie été dans le commerce, le labeur aux champs n’était pas sa tasse de thé, ramasser les patates ne l’emballait pas du tout, pas plus que la récolte du maïs. Le salaire était maigre, pourtant il était bien content d’avoir trouvé cette occupation, il nous disait, parlant de son patron : « Il en profite, il m’exploite au maximum. » Il n’avait pas le choix.
Dès notre arrivée, mon frère fut inscrit à l’école maternelle dirigée par madame Marie Bellocq, la directrice, et j’allais à l’école communale des garçons dont l’instituteur était Pierre Bellocq, son mari. C’est toujours avec émotion que j’évoquerai l’attitude de Marie et Pierre Bellocq. Pour ces personnes, respecter et accueillir ces familles en fuite et en détresse était un devoir naturel d’humanité et leur attitude d’aide et de compréhension ne faisait l’objet d’aucune hésitation. C’est avec une grande simplicité que madame Marie Bellocq et son mari Pierre aidèrent notre famille sans penser aux risques courus. « Je ne pouvais pas supporter que des enfants de quelque couleur, race ou religion soient-ils, puissent souffrir », me disait-elle après guerre.
Tous les Juifs de la région risquaient d’être à tout moment arrêtés et envoyés au camp de Gurs, antichambre de Drancy, puis des camps de la mort. Mon père Vitalis Farhi fut arrêté une première fois en novembre 1941 pour être conduit au camp de Gurs dans lequel il fut incarcéré pendant deux mois, libéré le 15 janvier 1942. La Turquie n’étant pas en guerre contre l’Allemagne, ses ressortissants étaient théoriquement protégés et ne pouvaient pas faire l’objet d’une arrestation. Mon père, né à Izmir, avait immigré vers la France en 1925 ; n’ayant pas effectué son service militaire en Turquie, il n’était plus reconnu par son pays et avait perdu toute nationalité. Il possédait un passeport Nancen, passeport réservé aux apatrides qui avaient perdu leur nationalité. Par chance, il avait conservé un acte de naissance turc, c’est grâce à ce papier qu’il fut libéré après deux mois de démarches incessantes auprès de l’administration préfectorale. Monsieur Pierre Bellocq ne ménagea pas sa peine pour intervenir auprès de l’administration préfectorale et permettre sa libération. Mon père sera arrêté une nouvelle fois pour être conduit au camp de Gurs le 27 février 1943 par la gendarmerie de Nay. Il y fera un séjour de quinze jours, ou peut-être un mois, en compagnie de son ami Albert Lévy. Ils furent libérés, une fois de plus grâce à leur soi-disant nationalité turque! Encore une fois les démarches et les relations de Monsieur Pierre Bellocq servirent.
Un Bulletin de recherche lancé par la préfecture des Basses-Pyrénées, gendarmerie de Pau, est émis en date du 18 octobre 1943 mentionnant que mon père avait quitté clandestinement son employeur. A compter de ce jour mon père ne dormira plus dans son lit avec sa femme, il se tiendra chaque nuit près de la fenêtre sur la rue afin d’entendre les gendarmes qui pourraient venir le chercher au lever du jour, prêt à s’engouffrer dans une cache préparée derrière un placard de l’appartement. Dès qu’ils revinrent du camp, conscients que ce subterfuge ne marcherait pas à tous les coups, nos parents voulurent mettre à l’abri leurs enfants. C’est tout naturellement que Pierre et Marie Bellocq leur proposèrent d’abriter leurs enfants chez monsieur Albert Labédays et madame Sidonie Marie, parents de madame Marie Bellocq. En cas d’arrestation les enfants seraient épargnés. Henri et moi-même avons été accueillis par cette famille pendant toute l’année 1943 jusqu’au mois de juin 1944, nous dormions et mangions chez eux, chaque jour nous pouvions voir nos parents qui habitaient à quelques centaines de mètres. Le risque d’abriter des enfants juifs était réel, la zone libre n’existait plus, les Allemands étaient là, les arrestations dans la région étaient nombreuses. Il faut savoir que Pierre Bellocq fut résistant dès 1942, il avait en charge le noyautage des administrations publiques dans la structure locale de Combat sur le village de Nay (voir l’ouvrage Aux armes! d’André Narritsens, Éditions de l’Institut CGT d’histoire sociale). Madame Bellocq avec laquelle nous évoquions cette période nous confia qu’elle ne connut qu’après la guerre le rôle important joué par son mari dans la lutte résistante.
Si je dois rendre hommage à cette famille, je ne peux oublier l’attitude des gendarmes de Nay qui devaient arrêter 6 juifs un matin de printemps 1944. La veille de l’arrestation, ils se rendirent au café du village pour boire un verre vers 19 heures, après les conversations d’usage avec le patron, ils laissèrent négligemment sur le comptoir la liste des personnes qui devaient être arrêtées le lendemain matin, six noms de juifs réfugiés. Cette information fut vite transmise dans le village. Mon père et ses amis disparurent cette nuit-là et se dispersèrent dans la région. J’ai probablement eu le tort de ne pas demander plus de détails à mon père avant sa mort, sur la vie qu’il a pu mener durant cette période jusqu’à la Libération. Une fois de plus Pierre Bellocq portera assistance à mon père et ses amis recherchés pour trouver des abris chez des amis sûrs. Mon père se cachera dans la campagne, dans un village situé à quelques trente kilomètres de Nay jusqu’à la Libération au mois d’août 1944.
Je venais d’avoir dix ans le 3 juin 1944. Mon père en fuite, la situation semblait de plus en plus incertaine et risquée à Nay, c’est pourquoi ma mère qui avait la nationalité turque, un passeport en règle et qui était reconnue comme telle par la Turquie, décida de fuir vers ce pays dans lequel vivait encore une grande partie de sa famille. Pour rejoindre Smyrne, Izmir aujourd’hui, il fallait en ce mois de juin 1944, prendre le train jusqu’à Paris, puis traverser l’Europe par l’Orient-Express jusqu’à Istanbul, quelle aventure… Nous passerons deux nuits et deux jours dans ce train, nous serons mitraillés sept fois, avec une scène qui se répétera comme dans un film, des blessés parmi les passagers, quelques morts aussi (je me demande aujourd’hui, comment ma mémoire d’enfant a pu oublier ou effacer ces drames), attentes, chaleur, fatigue. Arriverons-nous un jour en Turquie? Blois, terminus, tout le monde descend, adieu Paris, adieu Izmir et la Turquie, le débarquement a eu lieu en Normandie, dans la gare c’est un pagaille indescriptible. Finalement des hébergements seront organisés, nous serons orientés vers un centre de colonie de vacances tenu par des ecclésiastiques à Candé dans un petit château. Les parents seront logés dans une aile du château, les enfants seront mélangés dans les dortoirs aux autres enfants et participeront à la vie des vacanciers. Et puis, un soir, les prêtres responsables entonnèrent avec force La Marseillaise, les Allemands étaient partis, c’était la libération et la joie, on nous distribua du pain blanc. Nous regagnâmes Paris, mon père nous rejoignit quelques jours plus tard, la vie recommençait.
Il est temps de reconnaître et d’honorer les hommes et les femmes qui au risque de leur vie ont lutté, résisté dans l’anonymat sans exiger quelque récompense ou contrepartie que ce soit, se contentant de leur conviction du devoir d’humanité accompli. Pour ces personnes, apporter une assistance à des enfants et à des familles en fuite devant l’Allemand allait de soi. Si Pierre et Marie Bellocq, Albert et Sidonie Marie Labédays représentent l’exemple admirable de cet engagement, il me semble qu’il est aussi nécessaire d’associer le village de Nay au sein duquel beaucoup d’inconnus oubliés, aujourd’hui disparus, ont spontanément secouru les nombreuses familles juives en errance pendant ces années de guerre. Par l’évocation de ces souvenirs enfouis dans notre mémoire, nous manifestons notre désir de transmettre à nos jeunes générations l’exemple d’un esprit de justice et de tolérance. La xénophobie, l’intolérance, le racisme ne peuvent servir de base à quelque société que ce soit, tout autour de nous dans le monde ces principes sont utilisés par des pouvoirs dictatoriaux ou soi-disant démocratiques, par des groupes sectaires ou intégristes pour justifier arrestations, massacres et génocides.
Sur le site du comité français pour Yad Vashem